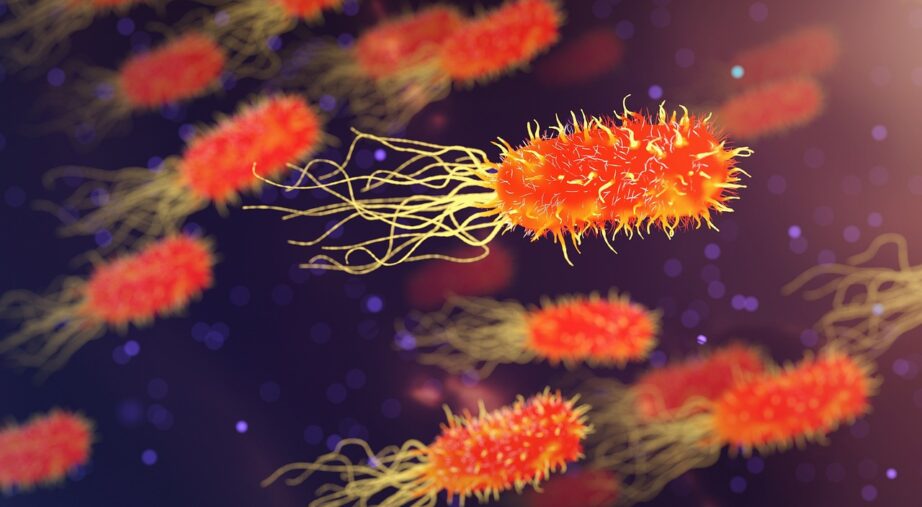Le 2 juillet, la Commission européenne a publié sa Stratégie européenne pour les sciences de la vie avec un objectif des plus ambitieux : faire de l’Europe “l’endroit le plus attractif au monde pour les sciences de la vie” d’ici à 2030. Plus exactement il s'agit de renforcer la recherche et l'innovation dans les domaines de la santé, de la bioindustrie et de l'agriculture.
L’Europe est aujourd’hui troisième dans ce domaine, mais doit rattraper les États-Unis et la Chine qui s'imposent comme remarquablement compétitifs. Cependant, face aux dernières évolutions sous l'administration Trump, l'UE souhaite tirer son épingle du jeu en insistant sur ses garanties de liberté académique, plus précaires chez ses concurrents.
Les axes de cette stratégie
3 axes prioritaires se dégagent de cette stratégie : le premier vise à optimiser l’écosystème européen de recherche et d’innovation, à travers un plan d’investissement destiné à faciliter le financement des essais cliniques multi-pays. Cet axe promeut également une approche "One Health", intégrant la santé humaine, animale et environnementale, et prévoit le financement de solutions fondées sur le microbiome, pour stimuler l’innovation industrielle et la durabilité.
Le deuxième axe entend accélérer l’accès au marché des innovations en biotechnologie, via un futur « EU Biotech Act », destiné à créer un cadre réglementaire plus favorable à l’innovation, et par le lancement d’une interface de mise en relation entre start-ups, industriels et investisseurs.
Enfin, la stratégie vise à renforcer la confiance dans l'innovation pour son adoption : 300 millions d’euros seront mobilisés pour stimuler les achats publics dans des domaines tels que l’adaptation au changement climatique, les vaccins de nouvelle génération ou les solutions abordables contre le cancer. Un groupe de coordination sur les sciences de la vie sera également mis en place pour assurer une meilleure cohérence des politiques et des financements.
Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la "Boussole de compétitivité" et repose sur les résultats d’une consultation publique ainsi que sur des études menées par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne.